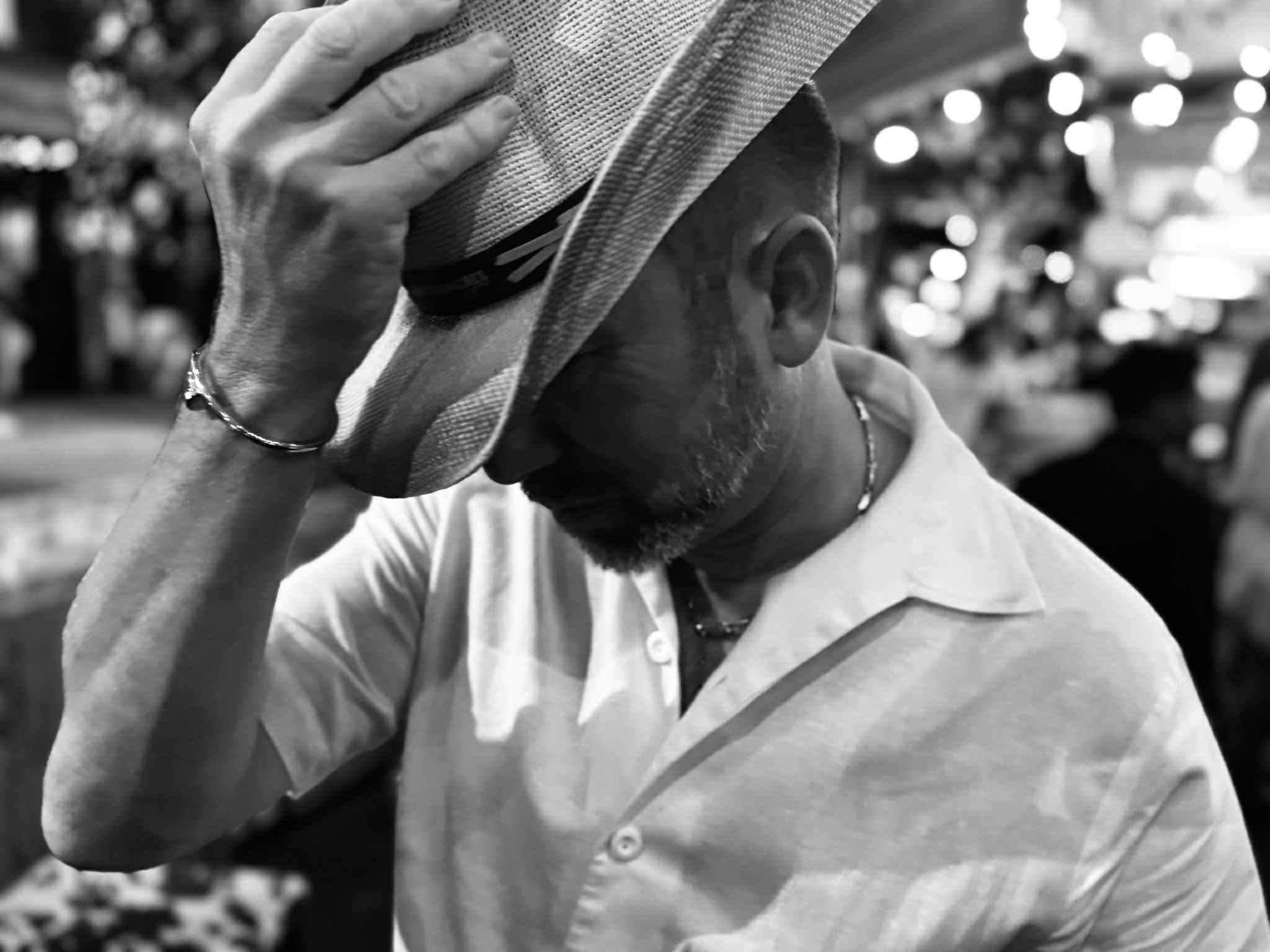Analyse jurisprudentielle d’une escroquerie au vrai faux chèque de banque. Un vendeur met sur internet son annonce, un acheteur est intéressé par le véhicule, sauf que, entre les deux, une tierce personne vient s’immiscer et va créer un faux profil d’un acheteur pour le vrai vendeur et un faux profil de vendeur pour le vrai acheteur sollicitant ainsi des informations au vrai acheteur, notamment carte d’identité et chèque de banque qu’il va ensuite présenter comme le faux acheteur au vrai vendeur et va répercuter les informations. En pareille escroquerie le vendeur escroqué peut-il imaginer se retourner à la fois contre la banque qui a émis le vrai chèque de banque et à la fois contre la banque qui a encaissé le vrai faux chèque de banque ?
Article :
Il convient de s’intéresser à une décision de justice qui a été rendue, une fois n’est pas coutume, par le Tribunal judiciaire de Draguignan ce 03 juin 2025, N°RG22/06047, et qui vient aborder la problématique des faux chèques de banque utilisés par un escroc dans le cadre d’une vente de véhicule.
Quels sont les faits ?
Dans cette affaire, Monsieur A a acquis en 2020 un véhicule d’occasion Audi A3 près d’un concessionnaire.
En 2022, ce dernier souhaitant céder ce véhicule a passé une annonce sur le site Le boncoin pour une cession au prix de 47 500.00 €.
Contacté par un acquéreur se présentant comme Monsieur O, il a cédé le véhicule au prix négocié de 45 000.00 €.
Or, préalablement à la finalisation de la cession, Monsieur A a transmis à son interlocuteur la copie de la carte grise du véhicule et a exigé en retour la copie du chèque de banque pour sécuriser le paiement du prix.
Suite à la réception de la copie du chèque de banque tiré sur la BPA sous le numéro 928297 établi à hauteur de 44 000.00 €, la cession du véhicule s’est effectuée en date du 08 janvier 2022 à Fréjus contre remise en mains propres à Monsieur A dudit chèque outre 1 000.00 € versés en espèces.
Le même jour, le certificat de cession de la vente a été enregistré sur le site de l’ANTS par Monsieur A.
Puis, le 10 janvier 2022, Monsieur A a déposé le chèque de banque auprès de son établissement bancaire.
Le 11 janvier 2022, la somme de 44 000.00 € a ainsi été créditée sur son compte par la banque.
L’escroquerie au vrai faux chèque de banque
Pour bien comprendre l’escroquerie en question, il convient de s’intéresser aussi au cas de l’acheteur potentiel, Monsieur O.
En effet, ce dernier, le 18 janvier 2022, avait effectivement fait établir un chèque de banque pour un montant de 44 000.00 € en vue de l’acquisition de ce fameux véhicule Audi dont la description correspondait à l’annonce établie par Monsieur A.
Se déclarant sans nouvelle de son vendeur qui ne s’était pas présenté au rendez-vous, Monsieur O a restitué ledit chèque de banque à son établissement bancaire, la BPA.
Par suite, le 21 janvier 2022, la somme de 44 000.00 € a été contrepassée du compte de Monsieur A par son établissement bancaire, le CIC, au motif que le chèque déposé était un faux.
C’est dans ces circonstances que le 22 janvier 2022 Monsieur A déposait plainte pour vol de son véhicule Audi suite à la remise d’un chèque falsifié lors de la vente et, le même jour, Monsieur O déposait plainte pour faux en écriture dont il se déclarait victime au motif que la cession du véhicule et le chèque avaient été réalisés en utilisant frauduleusement son identité.
Plainte déposée pour vol de véhicule
Ainsi, la mécanique est bien rodée dans le cadre de ce genre d’escroquerie très spécifique, un vendeur met sur internet son annonce, un acheteur est intéressé par le véhicule, sauf que, entre les deux, une tierce personne vient s’immiscer et va créer un faux profil d’un acheteur pour le vrai vendeur et un faux profil de vendeur pour le vrai acheteur sollicitant ainsi des informations au vrai acheteur, notamment carte d’identité et chèque de banque qu’il va ensuite présenter comme le faux acheteur au vrai vendeur et va répercuter les informations.
Le chèque de banque étant émis par le vrai acheteur, l’intermédiaire escroc ne fait que le répercuter au vrai vendeur, qui va vérifier les informations bancaires et qui ne pourra que constater que ces informations sont vraies puisque le vrai acheteur veut vraiment acheter mais là où le bât blesse c’est que lorsque le rendez-vous de vente a lieu, c’est le faux acheteur qui se présente avec un vrai/faux chèque de banque qui va amener à laisser penser au vrai vendeur que celui-ci est bien en présence du vrai acheteur.
La remise du véhicule contre un vrai faux chèque de banque
De telle sorte que le vrai vendeur remet le véhicule contre remise du chèque qu’il a fait certifier par avant en croyant qu’il avait affaire au vrai acheteur alors qu’il ne s’agissait que d’un faux acheteur et, de l’autre côté, le vrai acheteur se retrouve seul devant un rendez-vous où le faux vendeur n’est jamais venu car sa seule préoccupation était de récupérer des informations confidentielles lui permettant d’escroquer le vrai vendeur.
Sollicité à cette fin, l’assureur du véhicule de Monsieur A, le vendeur, a opposé un refus de prise en charge de sinistre au motif qu’il n’y avait pas eu de soustraction frauduleuse mais une appropriation frauduleuse du véhicule, risque non garanti par le contrat.
Appropriation frauduleuse ne vaut pas soustraction frauduleuse de véhicule
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier en date du 08 septembre 2022, Monsieur A a fait assigner le CIC, la BPA et Monsieur O, sollicitant leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 44 000.00 € à titre de dommages et intérêts, outre 5 000.00 € à titre d’article 700 du Code de procédure civile.
La question se posait de savoir si la banque CIC engageait sa responsabilité contractuelle.
Quelle responsabilité contre l’établissement bancaire ?
Rappelons par soucis de clarté qu’il s’agit de la banque qui a encaissé le chèque, soit, celle de Monsieur A.
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur d’une obligation contractuelle qui, du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier s’oblige à réparer.
Il revient au créancier qui réclame l’exécution de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage résultant.
Or, en l’espèce, Monsieur A reproche à la banque CIC, détenant son compte bancaire, d’avoir manqué à son obligation de vigilance en ne procédant pas aux vérifications utiles pour s’assurer de l’authenticité du chèque de banque.
Quelle anomalie apparente pour un vrai faux chèque de banque ?
La banque est en effet tenue de relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté et elle doit assumer les conséquences des risques qu’elle prend en s’en abstenant.
Il résulte des éléments de l’espèce, comme le souligne très justement la juridiction de fond, que Monsieur A a remis à son établissement bancaire un chèque de banque de 44 000.00 € tiré sur la BPA établi le 06 janvier 2022, chèque qui lui avait été remis au paiement du prix de vente de son véhicule.
Il ressort des relevés bancaires de Monsieur A que le montant du chèque a été crédité par sa banque sur son compte dès le 12 janvier 2022, puis, contrepassé en date du 21 janvier 2022 au motif que le chèque était faux.
Comment reconnaitre un vrai faux chèque de banque ?
Le constat du commissaire de justice établi en date du 30 novembre 2023 relève que le chèque falsifié de banque remis à son analyse présente au toucher un faible grammage et une mauvaise qualité.
L’impression du chèque est grossière et la qualité du papier qualifiée d’inférieur à la qualité du papier d’un chèque de banque.
L’officier ministériel relève également, après comparaison du chèque contrefait et du chèque original, effectuée le 06 février 2024, de nombreuses différences entre les deux chèques et l’absence de tampon humide outre la présence de deux signatures différentes sur le chèque contrefait et le décollement du papier.
Si, comme le souligne la banque CIC, la jurisprudence considère que seules les anomalies apparentes sont susceptibles d’engager la responsabilité d’un banquier qui ne les aurait pas décelé, les caractéristiques du chèque de banque tel que relevées par le commissaire de justice ne s’analysent pas en de simples différences mais bien en des anomalies matérielles multiples qui ne pouvaient échapper à la vigilance d’un employé d’établissement bancaire, celui-ci doit en effet être réputé spécifiquement formé à la détection des faux dès lors qu’il est habilité à recevoir les chèques de banque.
Les caractéristiques décelables d’un vrai faux chèque de banque
Il ressort également de l’examen attentif de l’original du chèque de banque contrefait remis sur l’audience qui figure au dossier de la société BPA que la mauvaise qualité du papier du chèque de la banque contrefait apparait immédiatement au toucher, ce qui aurait dû alerter l’établissement bancaire.
Cette anomalie, aisément détectable par un professionnel, aurait dû conduire la banque à une appréciation plus rigoureuse des nombreuses autres caractéristiques et anomalies relevées par le commissaire de justice sur le chèque contrefait comme notamment l’absence de tampon humide, la présence de deux signatures, la mauvaise qualité de l’impression, la mention de chèque de banque absente alors que ces nombreuses caractéristiques sont pointées par les recommandations de la banque de France.
L’obligation de vérification de la banque qui encaisse le vrai faux chèque de banque
Si la banque CIC soutient qu’elle a été vigilante en s’assurant auprès de la BPA de la réalité de l’émission de ce chèque de banque, notamment en l’interrogeant sur la présence de deux signatures, il convient de souligner que l’attestation qu’elle verse aux débats n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, outre le fait que cette attestation n’émane pas de l’employé qui a effectué leur vérification auprès de la banque BPA, force est de constater que sa force probante est relative puisqu’elle fait état d’une vérification effectuée le 24 janvier 2022, soit, postérieurement à l’encaissement du chèque de banque.
En revanche, il ne résulte pas des éléments de l’espèce contrairement à ce que soutient Monsieur A que la banque aurait failli à son obligation de conseil alors même que, dès le 14 janvier 2022, elle l’a informé du délai à respecter sur la disponibilité effective des fonds et a porté à sa connaissance le 21 janvier 2022 l’avis de rejet du même jour par la banque émettrice du chèque de banque, soit, avant l’expiration du délai de bon encaissement.
S’agissant du comportement de Monsieur A, s’il n’est effectivement pas établi par les éléments du dossier que celui-ci a procédé à la vérification de l’identité de l’acquéreur qui s’est présenté comme étant Monsieur O, sa négligence n’est pas de nature à exonérer la banque de sa responsabilité vis-à-vis de ses obligations particulières de vérifications de l’authenticité des instruments de paiement qui lui sont présentés.
La vérification de l’authenticité des instruments de paiements
En effet, Monsieur A, particulier non averti, a pu légitimement croire à l’identité de l’acquéreur qui l’a contacté via le réseau WhatsApp et a répondu à son annonce Le boncoin en se présentant sous l’identité de Monsieur O et en fournissant une copie du chèque au même nom.
De même, s’il ne peut être valablement soutenu que Monsieur A, particulier non averti, qui s’est vu remettre un chèque accompagné d’une somme de 1 000.00 € en espèces au moment de la transaction pouvait se convaincre de la contrefaçon du chèque tandis que celle-ci a échappé à la vigilance de l’établissement bancaire lui-même.
L’obligation de vigilance de la banque qui encaisse un vrai faux chèque de banque
Ainsi, la banque CIC, qui a encaissé le chèque, a donc manqué à son obligation de vigilance en procédant à l’encaissement du chèque sans avoir procédé aux vérifications préalables de son authenticité lors de sa remise et en procédant à son encaissement sur le compte de son client.
Le lien de causalité entre la faute reprochée à la banque et le préjudice revendiqué par Monsieur A est établi dès lors qu’en ne procédant pas aux vérifications de l’authenticité du chèque qui s’imposaient au vu de ses anomalies apparentes, Monsieur A n’a pas été alerté immédiatement de l’escroquerie dont il était victime et a déposé plainte avec retard, ce qui a diminué ses chances de récupérer son véhicule, le véhicule n’a jamais été retrouvé.
De telle sorte que la responsabilité contractuelle de la banque CIC sera retenue.
Quid de la responsabilité de la banque qui a émis le vrai chèque de banque ?
Concernant la responsabilité délictuelle de la banque BPA qui a émis le chèque,
Il résulte des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Ainsi, en matière banquière et financière, les produits et services fournis par la banque doivent présenter dans des conditions normales l’utilisation des conditions raisonnablement prévisibles, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
En l’espèce, dans cette affaire, Monsieur A reproche à la société BPA, émettrice du vrai chèque de banque, de ne pas avoir assuré la sécurisation et l’inviolabilité de l’instrument de paiement mis à la disposition de son client.
La banque émettrice du vrai chèque de banque doit-elle assurer la sécurisation et l’inviolabilité de l’instrument de paiement ?
Il ressort ainsi du constat d’huissier établi à la requête de Monsieur A que le chèque émis par la banque BPA présentait plusieurs caractéristiques de nature à assurer son inviolabilité et notamment présenter une clef de sécurité imprimée, un filigrane imprimé dans la masse, une impression de sécurité document original à l’encre nacrée au verso du chèque difficile à reproduire.
Il ressort de l’examen de l’original du chèque émis par la banque la présence au verso de plusieurs caractéristiques de sécurité détaillant les éléments permettant de déceler une tentative de fraude et notamment l’impression « chèque de banque » lisible par transparence ainsi que la mention « document original » à l’encre nacrée et l’alerte sur l’existence d’indicateur chimique intégré au papier en cas de falsification avec des encres courantes ainsi que le relève à juste titre la banque émettrice du chèque, le chèque qu’elle a émis n’a pas été ni falsifié ni altéré, l’escroc ayant établit un autre chèque comportant des mentions et une apparence différentes en se servant uniquement des données figurant sur la copie recto du chèque que Monsieur O, le vrai acheteur, a transmis par WhatsApp en vue de la finalisation de la vente du véhicule au faux vendeur.
Ainsi, la banque émettrice du chèque n’est pas à l’origine de la transmission de cette copie du chèque.
Ainsi et alors que le chèque qu’elle a émis était conforme aux normes de sécurité en vigueur, la banque émettrice du chèque ne peut être tenue responsable de la confection d’un faux chèque à partir de données qui figuraient sur la copie d’un chèque transmis par son client à son vendeur.
Par ailleurs, si Monsieur A soutient qu’il a été vigilant et s’assurant auprès de l’établissement bancaire de l’émission de ce chèque de banque lors de la transaction, il convient de souligner qu’il n’en rapporte pas la preuve.
En toute hypothèse, un chèque de banque ayant bien été émis par cette banque, il ne s’agit pas d’un élément portant à conséquence pour démontrer la vigilance de Monsieur A ni à l’inverse pour incriminer l’établissement bancaire.
S’agissant de l’attestation du directeur de la banque CIC, banque qui a encaissé le chèque, relatant qu’un agent de la banque émettrice du chèque aurait confirmé l’émission d’un chèque comportant deux signatures, outre le fait que cette attestation n’est pas établie par l’employé qui a effectué la vérification auprès de ladite banque, elle fait état d’une vérification téléphonique effectuée le 14 janvier 2022 sans lister les nombreuses anomalies de ce chèque qui auraient pu alerter la banque émettrice d’un risque de contrefaçon.
Il résulte par ailleurs des éléments de l’espèce que Monsieur O a restitué le chèque de banque que celle-ci avait émis, elle a procédé à son annulation, de sorte que l’établissement bancaire de Monsieur A en a été informé le 21 janvier 2022, soit, avant l’expiration du délai de bon encaissement fixé au 27 janvier 2022.
De telle sorte que, pour la juridiction de fond, aucune faute de la banque émettrice du chèque n’est établie dans cette affaire.
La responsabilité de l’acheteur manipulé face à un vrai faux chèque de banque
La question se posait également de savoir si oui ou non le vrai acheteur aurait commis une faute.
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur d’une obligation contractuelle qui, du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Il revient au créancier qui réclame l’exécution de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
L’attitude de l’acheteur évincé lors de l’escroquerie au vrai faux chèque de banque
En l’espèce, Monsieur A reproche à Monsieur O d’avoir tardé à restituer le chèque de banque original auprès de son établissement bancaire, ce qui a retardé la découverte de l’escroquerie et le dépôt de plainte subséquent.
Il ressort pour autant des éléments de l’espèce que, alors que la vente est intervenue le 08 janvier 2022 entre Monsieur A et le tiers qui s’est présenté sous l’identité de Monsieur O, Monsieur O a, quant à lui, restitué le chèque de banque original à son établissement bancaire le 18 janvier 2022, soit, dans un délai de dix jours.
Lors de son dépôt de plainte, Monsieur O explique que le vendeur lui a fait faux bond, qu’il a tenté de le rappeler le lendemain et il a restitué le chèque à sa banque quelques jours plus tard en raison de circonstances personnelles, tenant notamment à son état de santé.
Aucun délai n’est prévu pour la restitution d’un chèque de banque et, en l’espèce, aucune faute n’est caractérisée de la part de Monsieur O, la durée de dix jours constituant malgré tout un délai raisonnable et, contrairement à ce qui avait été soutenu par Monsieur A, le vendeur, aucun élément de l’espèce ne permet d’établir que Monsieur O aurait eu connaissance de l’escroquerie et y aurait participé de près ou de loin.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de Monsieur O, le vrai acheteur, a été écartée.
Sur le préjudice du vrai vendeur escroqué
Monsieur A réclame à titre principal l’indemnisation du préjudice subit du non-encaissement de la somme de 44 000.00 € correspondant au montant du chèque.
Or, si la responsabilité contractuelle de la banque qui a encaissé le chèque a été retenue pour manquement à son obligation de vigilance lors de l’encaissement du faux chèque de banque, il ne saurait lui être imputé cette réparation intégrale qui relève de la seule responsabilité de l’auteur de l’escroquerie dont Monsieur A a été victime.
En l’espèce, le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par Monsieur A s’analyse en réalité à une perte de chance, le manque de vigilance de la banque ayant diminué les chances de récupérer le véhicule en raison du délai de réaction de la banque qui a différé la date du dépôt de la plainte.
Monsieur A produit des statistiques ARGOS établies en 2023 mentionnant que 38,9 % des véhicules volés ont été retrouvés en 2022.
Cette étude indique que si un tiers des véhicules volés sont retrouvés dans la première semaine après le vol, ce taux s’élève à deux tiers dans le premier mois après le vol.
Il est établi par les pièces versées aux débats que le véhicule de Monsieur A a été verbalisé à Paris pour non-paiement d’un horodateur le 11 janvier 2022.
Il sera rappelé qu’il avait vendu le véhicule le 08 janvier 2022 et n’a été informé de l’escroquerie par sa banque que le 21 janvier 2022.
La quantification du préjudice en cas d’appropriation frauduleuse d’un véhicule
Si la notion de temps est déterminante dans la découverte des véhicules volés, il est manifeste que le fait pour Monsieur A de déposer plainte quatorze jours après la transaction a réduit ses chances de voir son véhicule retrouvé ainsi, bien qu’il ne soit pas certain qu’il aurait récupéré son véhicule s’il avait déposé plainte rapidement, l’éventualité de le retrouver existait d’autant plus en l’espèce que ce véhicule a fait l’objet d’une contravention à Paris le 11 janvier 2022.
Par suite, il y a lieu d’évaluer la perte de chance de Monsieur A de récupérer le véhicule à 35 % et, par même conséquence, de fixer le préjudice en découlant à hauteur de 35 % du montant du chèque correspondant à la partie de la valeur du véhicule non réglée au moment de la vente, soit, la somme de 15 400.00 €, la banque étant ainsi condamnée à réparer le préjudice à hauteur de ce montant.
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,
Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,