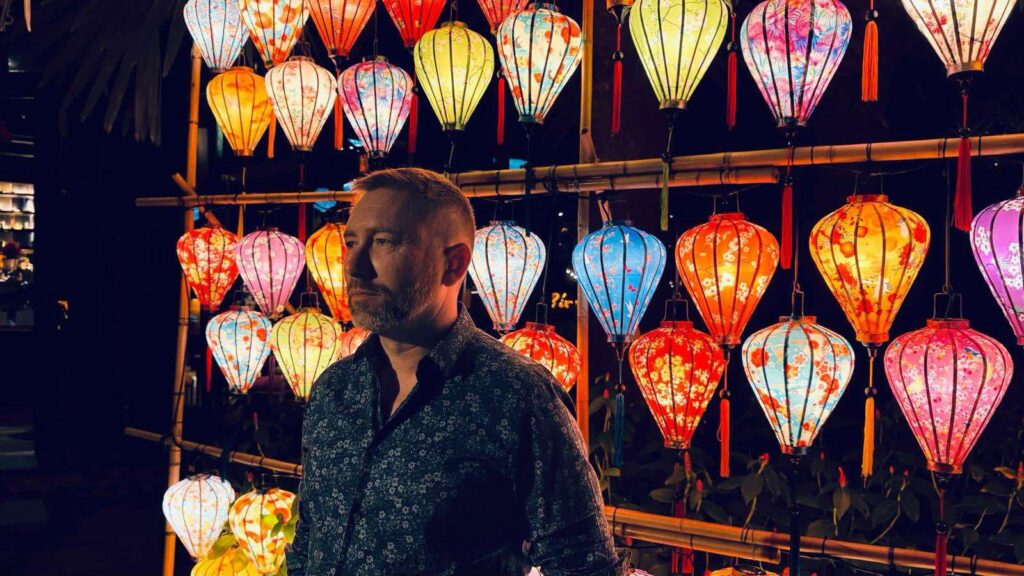
Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, un jugement d’adjudication est contesté à la fois par le débiteur saisi et à la fois par le fonds commun de titrisation intervenant à la place de la banque suite à une cession de créance. Dans quelles conditions un recours contre un jugement d’adjudication est possible ? Le débiteur doit-il être dument convoqué à l’audience d’adjudication ?
Article :
Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue ce 08 février 2024 par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, N°21-1870223 qui précise que :
« Commet un excès de pouvoir le Juge de l’exécution qui prononce l’adjudication du bien saisi sans s’être assuré que le débiteur a bien été appelé à l’audience d’adjudication. »
Ce qui fait que, immanquablement, les jugements de report d’adjudication devront faire l’objet d’une signification et il devra bien sûr en être justifié dans le dossier de la procédure, ce qui est, à mon sens, également un argument de défense pour le débiteur qui doit immanquablement être convoqué, au besoin, par voie de signification devant le Juge de l’adjudication pour manifester au besoin ses derniers moyens de contestation.
Quels sont les faits ?
Dans cette affaire, et selon jugement rendu par le Juge de l’adjudication du Tribunal judiciaire de Béthune le 25 mars 2020 rendu en dernier ressort sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque à l’encontre de Monsieur T, le bien saisi avait été adjugé à Monsieur I.
Monsieur T s’est pourvu en cassation soutenant que le mémoire déposé par le fonds commun de titrisation, au terme duquel celui-ci indique venir aux droits de la banque à la suite d’une cession de créance, est irrecevable dès lors que cette cession, qui ne lui a pas été signifiée conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil lui est inopposable.
Cependant, il ressort de l’acte de cession produit que celui-ci est soumis aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175 du Code monétaire et financier.
Les conditions d’acquisition ou de cession de créance
Selon l’article L 214-169, l’acquisition ou la cession de créance par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et les supports sont fixés par décret ou par tout autre mode d’acquisition de cession de transfert de droits Français ou étrangers par dérogation à l’alinéa précédent.
Les cessions de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectuent conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments.
Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments lorsqu’elle est réalisée par voie de bordereau mentionné au premier de l’article L 214-169, l’acquisition ou la cession de créance prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise quelle que soit la date de naissance d’échéance ou d’exigibilité des créances sans qu’il ne soit besoin d’autre formalité et ce, quelle que soit la Loi applicable aux créances à la Loi de Pays de résidence du débiteur.
L’opposabilité de l’acte de cession de créance au débiteur saisi
De telle sorte que, la Cour rappelle en tant que de besoin qu’il en résulte que l’acte de cession de créance n’avait pas, pour être opposable à Monsieur T, à lui être signifié.
Pour autant, Monsieur T venait également soulever d’autres moyens.
En effet, ce dernier soulevait que, selon l’article 615 alinéa 2 du Code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’Instance.
Ainsi, l’adjudicataire au profit duquel le bien saisi a été adjugé est partie au jugement d’adjudication dont il résulte que tout pourvoi formé contre cette décision doit être dirigé contre celui-ci et l’ensemble des autres parties.
Or, après avoir formé un premier pourvoi, N°21-18.702 à l’encontre de la banque, créancier poursuivant, et d’une autre banque et du Trésor public, créanciers inscrits, en a formé un second, N°23-10.075, à l’encontre de Monsieur I en sa qualité d’adjudicataire.
Le fonds commun de titrisation soutient que le premier pourvoi est irrecevable, faute d’avoir été dirigé contre l’adjudicataire, et que le second, qui ne l’a été que contre ce dernier, ne régularise pas la procédure.
Un pourvoi au contradictoire de l’adjudicataire ?
Cependant, la régularité affectant le pourvoi N°21-18.702, qui n’a pas été formé contre l’ensemble des parties au jugement d’adjudication, a été régularisé en application de l’article 126 du Code de procédure civile par le pourvoi N°23-10.075 dirigé contre l’adjudicataire.
Le pourvoi est dès lors recevable de ce chef.
Enfin, le fonds commun de titrisation et la banque soutenaient que le pourvoi était irrecevable en l’absence d’excès de pouvoir.
En effet, il résulte des articles 606, 607 et 608 du Code de procédure civile et de l’article R 322-60 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution que le jugement d’adjudication ne statuant sur aucune contestation n’est susceptible d’aucun recours sauf excès de pouvoir.
C’est sur ce point que la jurisprudence mérite également un intérêt tout particulier.
Le recours contre le jugement d’adjudication en cas d’excès de pouvoir
En effet, Monsieur T, débiteur saisi, faisait griefs au jugement de procéder à l’adjudication de son bien immobilier alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
De telle sorte que constituer un excès de pouvoir, le fait pour un Juge de statuer sans que le débiteur saisi ait été entendu ou appelé.
Qu’en procédant à l’adjudication du bien immobilier de Monsieur T, non comparant, sans que celui-ci n’ait été appelé à l’audience, le Juge de l’exécution a commis un excès de pouvoir et a violé l’article 14 du Code de procédure civile.
Une adjudication sans la présence du débiteur dûment convoqué
La Cour de cassation souligne en réponse, apporte quelques précisions, et vient préciser au visa de l’article 14 du Code de procédure civile qu’il résulte de ce texte que constituer un excès de pouvoir, le fait pour un Juge de statuer sans qu’une partie n’ait été entendue ou dûment appelée.
Ainsi, en prononçant l’adjudication du bien saisi alors qu’il ne résulte ni du jugement ni du dossier de procédure que le débiteur saisi avait été appelé à l’audience d’adjudication, le Juge de l’exécution a commis un excès de pouvoir et a violé le texte susvisé, amenant la Haute juridiction à casser et à annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Juge de l’adjudication du Tribunal judiciaire de Béthune.
Cette jurisprudence est intéressante à plus d’un titre.
Premièrement, elle rappelle qu’immanquablement la cession de créance n’a pas à être signifiée au débiteur saisi qui est tiers à la cession de créance.
Ce qui est à rappeler puisque bon nombre de débiteurs considèrent que la cession de créance aurait dû leur être signifié.
Concernant la problématique du pourvoi, lorsque celui-ci est fait avec une partie manquante, la Cour de cassation rappelle, et ça aussi c’est un point important, que le pourvoyant a la possibilité de régulariser sa procédure, ce qui est, à mon sens, un élément important.
Enfin et surtout, immanquablement, cette jurisprudence est liée aux conditions dans lesquelles l’adjudication doit se dérouler et force est de constater qu’il est reproché au Juge de l’adjudication de ne pas s’être assuré que le débiteur a bien été appelé à l’audience d’adjudication.
Ce qui a un impact évident puisque force est de constater que les jugements de report d’adjudication devront, à l’avenir, faire l’objet d’une signification et il devra en être justifié dans le dossier de procédure et, à défaut, le débiteur pourra éventuellement le contester.
Ce qui est, à mon sens, un élément important.
Il convient de même suite à cette jurisprudence de s’intéresser à une chronique qui avait été faite par Maître Christian LAPORTE, avocat à la Cour, qui avait fait l’objet d’une publication à la semaine juridique, édition générale, N°22, ce 03 juin 2024, qui vient aborder les hypothèses de la recevabilité exceptionnelle du pourvoi en cas d’excès de pouvoir.
La recevabilité exceptionnelle du pourvoi en cas d’excès de pouvoir
Cette jurisprudence, comme il le souligne dans sa chronique fort pertinente, rappelle qu’il est acquis conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’excès de pouvoir du Juge de l’exécution permet d’admettre la recevabilité du pourvoi en cassation contre le jugement d’adjudication qui n’a tranché aucune contestation.
Qu’en effet, rappelons pour la bonne forme que les dispositions de l’article R 322-60 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution offrent l’opportunité d’un appel du jugement d’adjudication qui n’est recevable que si une contestation a été émise, il doit être alors formé dans un délai de quinze jours de la notification.
À défaut, c’est le pourvoi de cassation qui s’impose en cas d’excès de pouvoir et mon Cher Confrère, Maître Christian LAPORTE, vient, dans sa chronique, aborder plusieurs points relatifs à la problématique d’aide juridictionnelle.
En effet, ce dernier rappelle en tant que de besoin que :
« Commet un excès de pouvoir le Juge de l’exécution qui ordonne dans le jugement d’adjudication la vente forcée du bien saisi sans s’être assuré de la décision du bureau de l’aide juridictionnelle et du nom de l’avocat désigné à ce titre alors qu’il en avait été informé par courrier de la demande faite par le saisi. »
Cour de cassation,
2ème Chambre civile,
24 juin 2010,
N°08-19.974
Maître LAPORTE précisant également que la Cour de cassation a :
« Jugé qu’en procédant à la vente forcée sans attendre la décision du bureau de l’aide juridictionnelle alors que la demande de l’aide juridictionnelle avait été faite avant l’audience d’adjudication, le Juge de l’exécution avait commis un excès de pouvoir. »
Cour de cassation,
2ème Chambre civile,
23 février 2017,
N°16-10.910
Cette jurisprudence, ainsi que l’étude qui en a été faite par mon excellent Confrère, Maître Christian LAPORTE, est intéressante puisqu’elle vient préciser que des voies de recours, même au stade de l’adjudication, peuvent être envisagées, tantôt par la voie de l’appel en cas de contestation qui aurait été tranchée, tantôt à titre exceptionnel en cas d’excès de pouvoir, bien que la jurisprudence soit limitante en la matière.
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,
Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,





